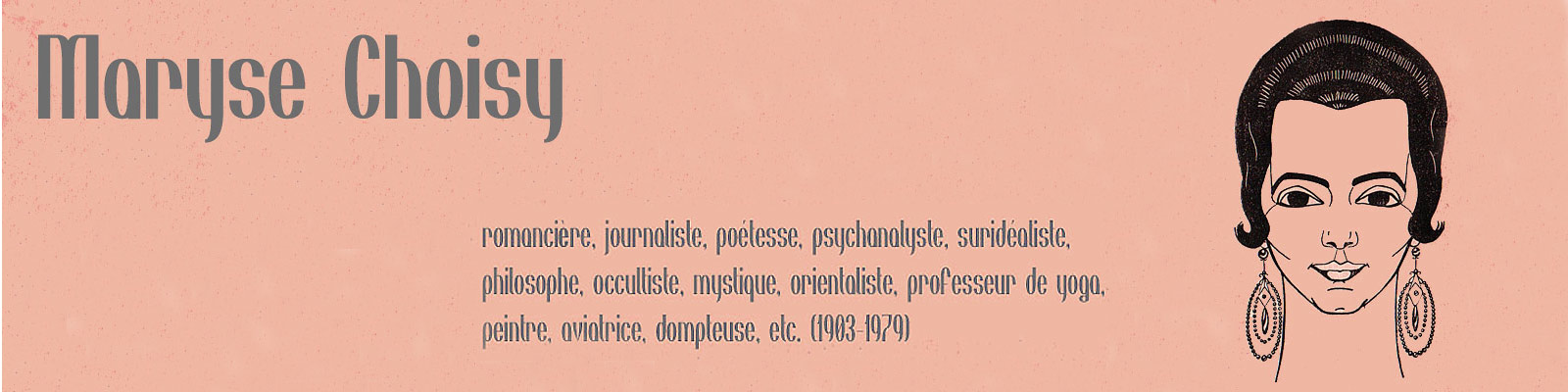Article paru dans Voila du 15 juillet 1933 :
CARNET D’UNE FEMME DE CHAMBRE 1933
I. DANS LES BUREAUX DE PLACEMENT
« Ah ! zut ! non, pas d’Américains. Ces banquiers américains se baladent toute la journée à poil. On ne reconnaît Monsieur de Madame que par certains détails. Non, moi je préfère que les patrons tiennent leurs distances avec les domestiques. »
Celle qui parlait était une brune longue et maigre, une araignée à qui on aurait enlevé quatre pattes. Des yeux de noisette et un nez de fouine. On la nommait Coco. Un coup de vent la projeta du cabinet de Madame Petoux parmi nos haleines en attente… Attente de quoi ?… De la bonne place, parbleu ! De la place tout en or, de la place où il n’y a pas d’enfants, de la place où Madame ne « vous court pas toujours sur le dos » ; de la place où Monsieur ne prend pas de tisane le soir et ne vous fait pas un enfant le matin ; de la place où Madame ne vous dit pas : « Enlevez cette robe », parce qu’elle vous trouve plus jolie que sa propre conception d’elle-même ; de la place où l’on peut faire de la gratte au marché. Bref, de la place idéale, de la place qui n’existe que dans les rêves des toutes jeunes bonnes…
Encore une fois, je change de peau. Je cherche une situation sociale. Je veux être femme de chambre. Je m’appelle Paulette. J’ai des papiers d’identité au nom d’une vraie Paulette, un certificat de Madame Victor Margueritte, un autre certificat d’un authentique comte qui descend de Radegonde ou d’Ermyntrude. Mais le plus beau certificat, c’est celui que je me signe, moi-même, Maryse Choisy, à cette autre moi-même d’un mois : Paulette… On n’est jamais bien servi que par soi-même… Je me trouve tant d’excellentes qualités que j’arrive à envier mes futurs patrons…
Ainsi, armée des pieds à la tête de certificats et d’une âme de boniche, je me suis présentée au Bureau de Placement de la rue du Colisée… Déjà trente-trois ans plus tôt, en 1900, Octave Mirbeau écrivait dans Le Journal d’une femme de chambre :
« Le bureau où j’avais eu la bêtise de m’inscrire est situé rue du Colisée, dans le fond d’une cour, au troisième étage d’une maison noire et très vieille, presque une maison d’ouvriers. »
Ce bureau a mis trente-trois ans pour descendre dans la rue et pour changer ses « murs suintants qu’on dirait hantés de larves visqueuses et de froids crapauds » en une boutique bourgeoise, ni propre ni sale. Ce qui importe, c’est de séparer nettement l’air aristocratique respiré par les maîtres et l’atmosphère de métro suffisante pour les domestiques.
Il n’y a pas que la boutique. Les domestiques, eux aussi, sont « descendus dans la rue » depuis Mirbeau. La femme de chambre de Mirbeau et tous ses collègues sont de droite, royalistes et anti-dreyfusards. Le livre est baigné dans une atmosphère de boulangisme. Labori, l’avocat de Dreyfus, ne trouve pas de bonnes pendant trois ans. Et la Célestine de Mirbeau, elle-même, bien qu’elle meure de faim et qu’à cette époque, il n’y ait pas encore de fonds de chômage ni d’assurances sociales, refuse avec indignation de se placer chez Labori.
Aujourd’hui, elles connaissent Lénine. Elles ont la tête farcie de revendications syndicalistes.
Une grosse paysanne — normande peut-être ou bretonne — avec des joues comme des pommes et des fesses comme des oreillers, se lance dans un réquisitoire sévère contre les comtesses :
— Les comtesses, je n’aime pas ça. Je n’en veux plus. Elles sont toutes insupportables. Il faut dire : « Madame la Comtesse par-ci, Madame la Comtesse par-là »… Aussitôt après la guerre, quand on manquait de domestiques, elles se contentaient d’un simple Madame, comme vous et moi. Maintenant, avec le chômage, elles réexigent qu’on leur donne du Madame la Comtesse à tous les plats.
On s’imagine en… 89, ma foi !
La grande maigre grandit encore de cinq centimètres :
— Moi non plus, je ne peux pas m’abaisser à ça.
Madame Petoux l’a entendue en venant appeler une de ces demoiselles (ma parole ! on se croirait au… chose). Elle la réprimande avec une tristesse digne :
— Pourquoi êtes-vous raide comme ça ?
— C’est pas « faisable ». (Elle dit fésable avec un faux air de Faubourg Saint-Germain chipé à je ne sais quelle comtesse détestée.) Ce n’est pas fésable, s’entête l’araignée. En un sens (une autre de ses expressions favorites), je ne peux pas m’abaisser tout le temps. C’est mon personnage. Que voulez-vous on a son personnage (sic).
Madame Petoux ne veut pas perdre son temps à changer les « personnages » des autres… Elle s’adresse à Irène :
— Alors, cette place ?
La blonde Irène prend un air dégoûté jusqu’à la pointe de ses taches de rousseur :
— Trois cent cinquante francs et des enfants ! s’écrie-t-elle avec indignation. Des enfants, ça salit le parquet en bas quand il pleut… Ça se lave dans des bols comme des grandes personnes. Je vous demande un peu… Et ça n’en finit pas de manger !
Madame Petoux l’interrompt :
— Ma petite, une place qu’on a ratée, c’est comme un homme qui vous a plaquée. Il ne faut pas en parler.
Une qui n’a pas dû changer depuis Octave Mirbeau, c’est Madame Petoux. Elle est immortelle comme un lion homicide dans une ménagerie. On imprime une grosse pancarte : « Lion très dangereux. A tué son dompteur le X… janvier à X…, dans des conditions terrifiantes. » Et les badauds de s’attrouper. Quand le lion original meurt, on met un autre lion sous la pancarte. Le public ne voit pas la différence et paie pour s’approcher du fauve dangereux.
Ainsi Madame Petoux. Depuis qu’il y a des bonnes et depuis qu’il y a des Maîtres, elle a dû venir au monde comme Minerve, toute habillée de sa robe noire, de sa chaîne d’or et de ses seins qui ne tiennent pas dans un équilibre stable.
Madame Petoux est une parodie de la dignité. C’est peut-être une ancienne femme de chambre. Elle tient à la fois de la sous-maîtresse, du confesseur, de l’introducteur des ambassades, de la marieuse clandestine. Elle connaît les secrets de Paris, l’état des comptes courants, les adultères, les misères intimes. Elle prévoit les divorces. Elle a des opinions sur le phylloxéra, la Conférence Économique et la verrue d’Irène. C’est une concierge qui a bien tourné. Elle a des yeux dans le dos et des rayons X dans les yeux. Elle est toujours très convenable.
— C’est une chichiteuse, a conclu Irène. Quelle poseuse ! Elle dit zut au lieu de dire m… comme tout le monde.Ses petites (comme elle appelle les domestiques qui viennent solliciter une place rue du Colisée), ses petites, elle les confesse comme un commissaire aux Délégations judiciaires doublé d’un Jésuite à la voix tendre. Elle connaît les patronnes et les employées comme « si elle les avait faites. »
Dès qu’elle me repère, elle me scrute d’un regard à la fois inquisiteur et gras. Elle tâte les muscles de mes bras, se demande si mon mollet plaira à ma future patronne. Tout d’une entremetteuse. Où suis-je ? Dans un bureau de placement ou… ?
— Que savez-vous faire ?
— Tout et rien…
— C’est-à-dire pas grand’chose. Vous êtes comme tout le monde. Enfin, on va vous inscrire. Je crois que j’ai quelque chose pour vous !…
… Quand elle s’en va, nous continuons à bavarder. Que faire en attendant la place idéale, sinon parler des places anciennes ?
Chacune raconte ses malheurs, débine les maîtres. On ne les appelle pas des singes. On dit le plus souvent : « Eux ». Irène les a baptisés les « topinambours ». Nous sommes là, en masse et en mots, cuisinières et femmes de chambres, valets et bonnes à tout faire dans une pièce étroite qui a des bancs pour tout meuble. De l’autre côté, il y a le bureau de Madame Petoux, où elle reçoit les « topinambours ».
Le soir, quand nous pouvons enfin traverser le couloir qui mène au bureau de Madame Petoux et qu’elles sont parties, certaines bonnes semblaient éprouver un singulier plaisir à s’asseoir sur les fauteuils où, une heure plus tôt, se sont assises toutes ces comtesses, duchesses et autres altesses abhorrées. Je pense, je ne sais trop pourquoi, aux rouges qui ont envahi le salon de l’Empereur le soir de la révolution à Vienne ; à Kerensky qui dormit dans le lit du Tsar. Tout cela est très humain.
Il y a là les habituées de l’Agence :
La superstitieuse : Celle qui vient solliciter une place avec un fer à cheval qu’elle a volé chez la demi-mondaine qu’elle a servie en dernier lieu. (Il paraît qu’un fer à cheval doit être volé à une courtisane pour porter effectivement chance.)
L’intellectuelle : Elle ressemble beaucoup à la Célestine de Mirbeau. Elle a des lectures et des prétentions. Elle raisonne mal et fait son travail plus mal encore. Mais elle est le chef, en quelque sorte. Chaque groupe a son chef. Ce sont toujours les mêmes qui sont les chefs.
La grosse : C’est une campagnarde toute en saindoux. Bonne fille… Sauf lorsqu’on parle des topinambours. Vite essoufflée. Toutes les besognes lui semblent dures et tous les salaires insuffisants.
La maigre et méchante : C’est la plus drôle et la plus potinière de toutes. Jamais contente, jamais ennuyeuse. Elle connaît des histoires sur Tout-Paris. À cause de sa petite taille, elle se faufile partout. Peut-être indic. Peut-être simplement vache.
La niaise : Elle débarque de Carpentras. Dans chaque communauté, il y a aussi le bouc émissaire qui fait toutes les corvées et dont on se moque. À celle-ci, on lui refile toutes les places dont personne ne veut. Elle est laide, par-dessus le marché.Certaines bonnes semblaient éprouver un singulier plaisir à s’asseoir sur les fauteuils destinés aux « maîtres ».
L’avachie : Personnage du cinéma muet. Elle en a vu des choses, sans voir.
La sex-appealante : Jolie. Des yeux comme la mer. Des cheveux comme le sable. Un air du mois d’août. Elle ne restera pas longtemps boniche. Déjà bien mise, en préparation pour les festins futurs.
C’est elle que la placeuse (pardon ! j’allais dire la sous-maîtresse) interpelle :
— Ma petite, j’ai une place de femme de chambre pour vous. Mais la dame demande qu’on la coiffe. Savez-vous coiffer ?
Hélène, la sex-appealante, réplique fièrement :
— Comment voulez-vous que je sache coiffer ? J’ai mon coiffeur.
À peine Madame Petoux est-elle partie que le couplet sur la haine des classes se déclenche :
— Quelle vie d’esclave ! soupire Hélène. Sans compter qu’elles sont toutes moches et toutes jalouses… On les a eues après la guerre. Maintenant, c’est elles qui nous ont de nouveau.
— Ils disent : « Les domestiques ne sont pas stables ». Mais ce sont eux qui ne le sont pas. Ils ont des idées de changement. Ils bougent tout le temps. Ils n’ont qu’à être stables, eux, et ils verront que les domestiques le seront.
Voici de nouveau la robe noire, la poitrine froufroutante de Madame Petoux. Cette fois, c’est pour moi.
— J’ai une place en or pour vous. Une dame seule. Elle reçoit beaucoup. Il y a un maître d’hôtel et une cuisinière. Vous aurez juste à vous occuper d’habiller Madame, de veiller à ses fantaisies et à sa sécurité. (Le sens de ce mot-là, je ne l’ai compris que plus tard.) Cinq cents francs par mois. Si vous n’êtes pas contente.
Madame Petoux m’emmena dans le salon. Jamais entrevue ne fut plus émouvante. Elle (ma future patronne) me regarda à travers le snobisme grossissant d’un face-à-main. Un regard de bête-à-bête sans paroles. Tout de suite, je sentis que j’allais la détester. Il est impossible de ne pas détester sa patronne. Surtout celle-là. Sûrement une dinde… Du tréfonds de nos féminités, naquit brusquement cette haine spontanée des femmes qui savent qu’elles vont se nuire tôt ou tard…
Tout à l’heure, j’avais été angoissée par cette explosion de haines autour de moi… Des vagues relents de guerre des classes, du Grand Soir, trottaient comme des papillons noirs dans mon cerveau… Maintenant, je comprends tout. La haine du domestique pour celui qui l’emploie est de tous les temps, de tous les âges et totalement étrangère à la révolution communiste… On hait son maître parce qu’il vous oblige à se montrer inférieure à vous-même pour ne pas paraître plus intelligente ou plus belle que celle qui est socialement la supérieure… C’est cet amoindrissement de « son personnage » qu’on ne pardonne pas.
Comme dit Coco l’Araignée :
— Ce topinambour-là n’est pas « fésable » en un sens…
En aucun sens d’ailleurs.
Elle me soupesa, m’évalua, m’estima… Une vache, quoi !
— Vous sortez beaucoup ? Vous avez un ami ?
… Heureusement qu’elle oubliait les questions au fur et à mesure qu’elle les posait.
Elle m’expliqua :
— Je tiens essentiellement à ce que vous promeniez mon toy-terrier quatre fois par jour. Il faut le laver, le désinfecter, lui prendre sa température, l’aimer…
… Quoi encore ?…
Un dernier regard qui m’enveloppe dans une couverture de glace.
Puis Elle décide :
— Cette petite me convient.À moi, elle ne me convenait pas du tout. Mais enfin, il ne fallait pas être trop difficile. J’étais engagée. C’était l’important.
Quand je montrai la carte de visite de ma future patronne, Coco l’Araignée poussa de hauts cris :
— Mimi Salmigondis ! Vous auriez dû refuser. C’est épouvantable de tomber chez une poule entretenue. Ça, vraiment, ce n’est pas fésable en un sens. J’ai été quinze jours chez Mimi Salmigondis. Ah ! la ! la ! la ! Elle m’a emprunté de l’argent que je n’arrivais pas à me faire rendre. À la fin, pour rentrer dans mes sous, je l’ai menacée d’aller trouver le vieux qui payait et de lui raconter tout ce qui se passait pendant son absence. Elle avait deux ou trois gigolos qu’elle entretenait avec l’argent du vieux. J’ai dit la vérité au vieux qui m’a rendu l’argent avec félicitations.
… Eh bien ! Ça promet, ma nouvelle place…
Maryse Choisy