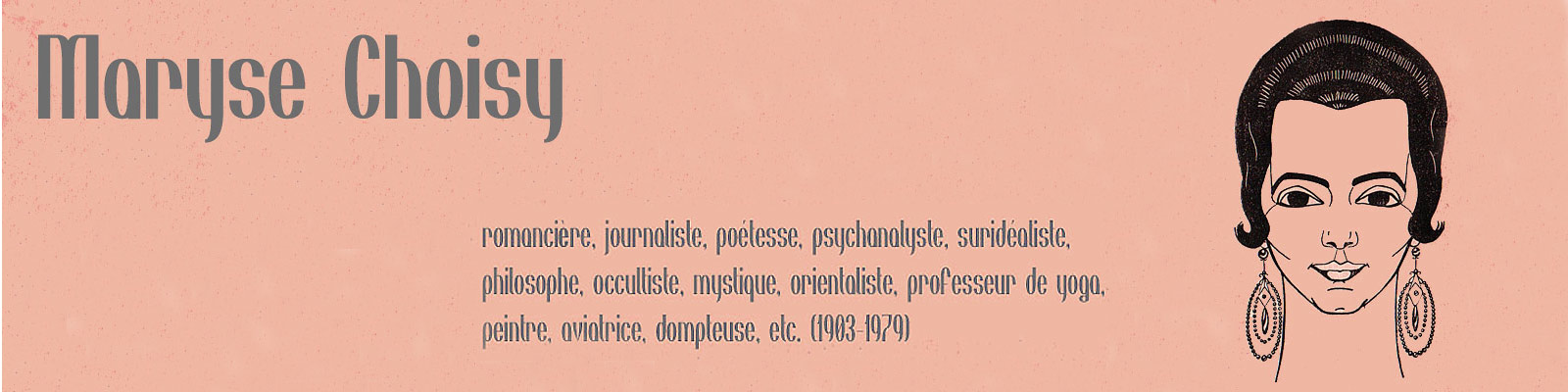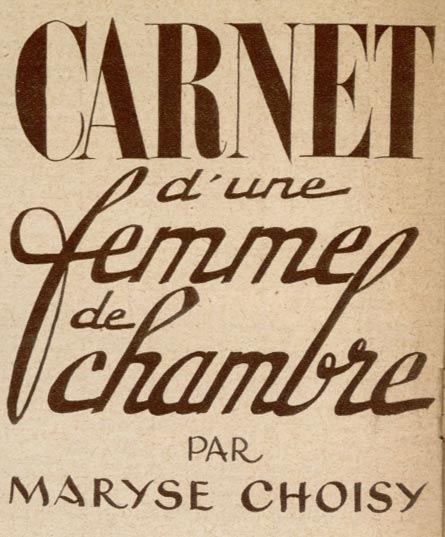Article paru dans Voilà du 29 juillet 1933 :
III. MÉNAGES DE COURTISANES
(suite du deuxième épisode :
II. L’étage des bonnes)
Je sors avec Jean, me dit ma patronne. Si Paul arrive, vous lui direz que je suis allée aux courses. Mais si c’est Pierre qui vient, vous lui demanderez d’attendre. Et si Jacques m’apporte un bouquet de fleurs, vous lui donnerez rendez-vous au Colisée. Vous avez compris, Paulette ?
Je n’avais rien compris du tout. Je sais seulement que la vie ici est une éternelle danse sur la corde raide, qu’on côtoie le drame et le vaudeville à chaque coup, que le mensonge — est la chose la plus délicate au monde.
La maladresse menteuse des petites femmes est compensée par l’incroyable capacité du mensonge chez les hommes. Je n’ai jamais pu comprendre que Jean, Paul, Pierre, Jacques, qui, dans la vie ordinaire sont logiques et roublards, arrivent à croire avec tant de naïveté, les histoires cousues de câble que Mademoiselle invente au fur et à mesure de ses besoins.
Aucun des quatre Messieurs de Mademoiselle n’est un gigolo. Mais Paul est le banquier principal. C’est le plus jeune.
— Plus un homme est jeune et plus il est facile de lui faire accroire qu’il est aimé pour lui-même, m’a expliqué Mimi Salmigondis. Et ce n’est que quand un homme est persuadé qu’il est aimé pour lui-même qu’il les lâche vraiment.
Le plus vieux de tous, c’est Jacques. Il a 65 ans. Jacques connaît l’existence de Pierre, de Paul et de Jean. Il joue au gigolo. Le fait que Mimi l’ait choisi pour tromper Pierre, Paul et Jean lui donne l’impression qu’il est aimé pour lui-même, malgré sa tête chauve, son ventre en proue, sa bosse en poupe et son air généralement dégoûtant. C’est parce qu’il est gigolo que Jacques consent à régler quelques menues dépenses du ménage et à donner à Mimi en plus d’une fourrure ou d’une gâterie par-ci par-là, un peu d’argent de poche. Jean est chargé de la garde-robe de Mimi, et Pierre de sa publicité, du lancement de ses affaires, cinéma, théâtre, etc.
La vie de Mimi est une éternelle course entre deux placards. Heureusement qu’il y a beaucoup de placards et beaucoup d’issues.
Je n’ai jamais entendu Mimi me dire :
— Époussetez donc ce buffet.
Mais elle me fait constamment des recommandations comme celle-ci :
— Vous ferez sortir par la porte A pour qu’il ne rencontre pas Pierre qui entre par la porte B.
Cela établit entre Mimi et sa domesticité cette familiarité qu’on ne rencontre que chez les grandes courtisanes. Cela rend les domestiques insolents et la patronne timide.
Un jour, je me souviens, elle s’était brouillée avec son quatuor. Ça allait très mal. Nous n’avions même plus d’argent à lui prêter. Elle s’était trouvée soudain sans un sou dans son bel appartement. Le gaz fut coupé. Plus de gaz, plus de cuisine.
Heureusement, il est un dieu pour les courtisanes. Mimi rencontra chez une amie un fort riche Américain qui l’invita à déjeuner pour le lendemain.
Elle l’attendait à l’heure convenu, le cœur battant et le chapeau sur la tête. Il ne fallait pas qu’il sût que le gaz était coupé. Mais l’Américain voulait faire une surprise. Il apporta une langouste vivante.
— Je aimais mieux déjeuner dans votre appartement, expliqua-t-il. Voici une langouste vivante.
Mimi Salmigondis ne fut embarrassée qu’un seul instant. Elle eut un trait de génie et s’écria, vive et primesautière :
— Pauvre petite bête ! J’ai peur qu’elle ne meure sans eau. Je vais la mettre dans une baignoire. Je n’ai jamais pu manger un animal qu’on m’a présenté dans un salon. Je suis trop polie. J’aime mieux aller chez Prunier.
*
* *Aujourd’hui, pour sortir avec Jean, Mademoiselle s’est faite très belle.
Après force massages, douches, frictions, truquages, tapotages, vernissages, maquillages, poudrages, replâtrages, Mademoiselle est sortie au bras de Jean, fraîche comme une rose de serre et toute équipée pour taper ses hommes de cent billets.
Malheureusement, par ce clair dimanche d’été, ses quatre hommes ont eu tous la même idée lumineuse : sortir comme un placard de publicité cette maîtresse élégante, qu’ils n’osaient chiffonner parce qu’ils savaient combien chères étaient les notes de ses couturiers.
Cela prouverait, si on ne le savait déjà, le manque d’imagination des hommes.
Mais ils ne me laissèrent guère le temps de philosopher sur leur cas. J’avais confondu toutes les recommandations de Mademoiselle, qui, d’ailleurs, n’étaient pas très claires. Ce fut Jacques qui se présenta le premier.
Il bégaya longtemps comme un jeune sénateur :
— M… M… M… Mad… demoiselle ne d… d… dev… vait pas sort… tir s… ans… ans… m… m… oi… O… où… où… est-el… elle ?
J’étais affolée. Je ne me souvenais plus si je devais l’envoyer au Colisée, aux courses, ou au… bain.
Je n’avais pas eu le temps de trouver une réponse que déjà se présentaient Pierre et Paul.
— Vite, entrez dans un placard, criai-je au vieux.
Mais le « vieux » ne voulait rien entendre. Et comme il vit arriver Paul, le principal banquier, il voulut savoir, à tout prix, avec qui se trouvait Mimi. Ce vieux de soixante-cinq ans voulait bien supporter un banquier, mais pour rien au monde il ne tolérerait un autre gigolo que lui.
Paul s’aperçut, à ce moment-là, à quel point il était bafoué. Ce fut atroce, abominable, tragique et vaudevillesque. J’avais complètement perdu la tête. Et Joseph qui n’était pas là… ni la cuisinière… Seule, en ce dimanche d’été, sans expérience devant de telles responsabilités.
Sur ces entrefaites, rentra Mademoiselle avec son Jean.
De l’air le plus naturel du monde, elle dit à ces messieurs :
— J’ai une migraine terrible.
Désignant Jean, elle ajouta :
— Monsieur que voici avait été assez aimable pour me conduire chez son médecin. Mais, naturellement, comme c’est dimanche, le médecin n’était pas là… Je suis vraiment très fatiguée.
Seul, Paul, qui était violent, fit une scène.
Alors, Mimi Salmigondis eut recours à la plus grande arme des femmes : les larmes.
Elle se tordit littéralement dans une véritable crise de nerfs.
— Les hommes, vous êtes tous des mufles, des égoïstes, pleurait-elle. Vous martyrisez une pauvre et faible femme, malade et sans force.
Les hommes « mufles et égoïstes » se retirèrent vaincus et penauds. Ils étaient bien élevés.
Après leur départ, Mademoiselle se mit à rire. Elle était heureuse que sa bonne blague ait réussi.
Cela ne l’empêcha point de me gronder et de me donner mes huit jours. Avec l’injustice innée des femmes, elle me reprocha :
— Paulette, vous n’êtes bonne à rien. Si vous vous affolez pour trois pauvres petits mâles, vous ne ferez pas du tout mon affaire..MÉNAGES DITS BOURGEOIS
Il y a des gens qui s’imaginent avoir découvert les parties fines, l’amour devant témoins, les caresses gantées et les emmêlements du Bois. De tout cela il est déjà parlé dans Le Journal d’une femme de chambre, en 1900. Mirbeau en connaissait long sur les couples qui cherchent d’autres couples pour partager toutes les joies de l’existence.
Néanmoins, les bourgeois de Mirbeau demeurent pudiques devant les serviteurs. J’ai rencontré dans une place où je n’ai pas fait long feu un couple qui n’arrivait pas à être heureux si tous les voisins et les domestiques ne le contemplaient dans sa nudité active.
Monsieur est un industriel fort connu, grisonnant, digne et maigre. Son père est président de la Chambre des Notaires à N… Dix générations de protestantisme lui ont donné des rides sévères et un refoulement à réjouir Freud lui-même.
Madame est une rousse boulotte, pas trop laide, à l’âge où la femme est mûre pour les plus fortes joies sensuelles. Un extérieur atrocement correct. Vêtue de noir neuf fois sur dix. À cheval sur l’étiquette et pas assez à cheval dans la salle de bains.
Ce fut Madame qui m’engagea. Elle m’examina des pieds à la tête, me demanda d’un ton aigre si je portais des véritables bas de soie.
— Si vous n’en avez pas, je vous en prêterai. Mon mari exige des bas de soie.
Quoi encore ! Faire le ménage en 44 fin… À moins qu’il y ait autre chose !
Extérieurement, l’intérieur de Madame était fort bien tenu. Pas un grain de poussière n’était toléré. On est des bourgeois, et non pas un ménage de courtisane. Mais je remarquai bien vite que les soupers intimes prenaient facilement des allures de désordre.
D’abord, mes patrons étaient nudistes convaincus. Monsieur aimait beaucoup faire souper sa femme en pagne et même nue avec de jeunes amis. Quand il avait pris plusieurs verres de leur Châteauneuf du Pape, Monsieur saisissait en main un sein de Madame et disait à ses invités :
— N’est-ce pas qu’ils sont beaux ?
C’était d’autant plus comique que ce n’était pas vrai et que si Monsieur ne les avait soutenus dans un équilibre plus ou moins stable, ils seraient passés sous la table.
C’était un ménage à trois, si l’on veut. Mais le troisième n’était pas toujours le même.
Mais tant que cela ne me toucha pas personnellement, je m’amusai beaucoup de leurs petites histoires malpropres. Ce fut autre chose, quand Monsieur se mit à me pincer le menton dans les couloirs et dans l’obscurité de l’escalier de service.
— Tu n’as pas d’amoureux, petite ? me demandait-il à tout propos.
— Non, monsieur.
Je dois avouer cependant qu’il n’allait pas plus loin que le menton.
La vraie musique, ce fut Madame qui la commença. Ce n’est que plus tard que je compris que les partenaires de ce ménage modèle 1933 « rabattaient » l’un pour l’autre.
Madame me manda dans sa chambre et me tint le langage suivant :
— Ma fille, sachez que si vous ne plaisez pas à Monsieur, il m’est impossible de vous garder…
Je haussai les épaules :
— Madame est aveugle, criai-je dans une crise de colère, je n’ai pas besoin de Madame pour cela, si je voulais. Mais c’est à moi que Monsieur ne plaît pas.
Elle sa fâcha beaucoup moins que je ne l’eusse supposé.
— Vous êtes une impertinente, fit-elle par acquit de conscience. En plus de cela vous vous vantez. Ah ! si vous pouviez dire vrai ! Si vous pouviez vraiment réveiller Monsieur, votre avenir serait assuré, ma fille.
Je vis confirmé à ce moment ce que j’avais toujours soupçonné : l’intense pauvreté sexuelle des vicieux. Cette petit Madame, avalant orgueil et amour-propre, essayait toutes les dragées d’Hercule morales pour attendrir son Maître et Seigneur.
Cette conversation dans la chambre de Madame eut des suites sérieuses entre Monsieur et Madame du côté de la salle à manger.
Chaque fois que j’entrais, Monsieur et Madame se taisaient. C’est un signe certain qu’ils parlaient de moi.
— Ils n’ont que trois sujets de conversation, m’avait déjà dit la cuisinière : la vie chère, le vice et nous.
Enfin à l’heure du dessert, je surpris Monsieur qui s’expliquait :
— Je ne sais pas si elle est saine après tout.
Et Madame d’objecter :
— Une réaction Wassermann est si vite faite. Elle n’y verra que du feu…
Je compris pourquoi une heure plus tard elle me dit, son petit nez de boulotte en l’air :
— Nous avons chaque année une tournée générale de la maison par le médecin de famille. Il va venir vous ausculter demain.
Voyez vous ça ! Monsieur qui veut un certificat prénuptial.
Je répliquai sèchement :
— Je remercie beaucoup Madame. Mais j’ai mon médecin des Assurances sociales.BONNES D’ENFANTS
De nouveau, je suis à la recherche d’une situation. J’en ai assez des ménages mondains et demi-mondains avec leurs petits vices, leurs grands mensonges et leurs hypocrisies moyennes. Je veux un ménage bourgeois, sage, un bon ménage de Français moyens ; pour cela, je m’engage comme bonne d’enfants.
Je trouve une place à Neuilly, chez M. et Mme Ploc. Ils ont trois enfants. Deux de plus que le Français moyen. Le plus âgé, Paul, a huit ans. Le plus jeune, Aristide, a un an. La fillette, qui s’appelle Aurélie, a cinq ans. (Ils ont la folie des noms compliqués, dans cette famille-là !).
La bonne qui était là avant moi était une Allemande qu’ils avaient fait venir à grands frais de Bonn et qui avait de beaux diplômes de puériculture. Elle possédait une façon toute particulière d’endormir Bébé. Le soir, quand Aristide faisait quelques difficultés devant son dodo, vite, elle lui mettait la tête sous le robinet de gaz. Et Bébé, au bout de cinq minutes, s’endormait jusqu’au lendemain. Ce régime-là durait depuis trois mois. Les médecins s’étonnaient que, malgré tous les bons soins, Bébé ne profitât pas davantage. Un jour, par hasard, Mme Ploc surprit le manège. Cris, hurlements, tapage…
J’ai donc, sous ma responsabilité, un bébé à moitié abruti, gâté, mal élevé et qui crie. Autre chose est de soigner son enfant à soi et autre chose de nettoyer les langes des enfants d’autrui.
Je ne veux pas dire que Mme Ploc soit tellement occupée par ses obligations mondaines. Elle est pire qu’une femme du monde. Elle n’a ni travail, ni responsabilité. Elle est fatiguée de ne rien faire. Elle respire difficilement dans ses soixante-dix kilos de graisse et dans un corset d’avant-guerre. Par exemple, elle ne plaisante pas avec les comptes de cuisine.
L’autre jour, elle m’a dit sévèrement :
— Bébé emploie pour son biberon une boîte de Nestlé tous les trois jours. Comment se fait-il que vous ayez acheté une boîte de Nestlé le 15 et une autre le 17 ? Vous seriez-vous permis, par hasard, d’en faire usage pour vos besoins personnels ? Je vous défends de voler du lait de Bébé.
Je lui dis la vérité :
— J’en ai renversé un peu l’autre jour, parce que Bébé a repoussé son biberon du pied.
Mme Ploc me réprimanda sans bienveillance :
— Que cela ne vous arrive plus ! En tout cas, je déduis le prix d’une demi-boîte de Nestlé de vos gages.
Je me console philosophiquement par cette vérité que j’ai apprise déjà ailleurs : les gens qui n’ont pas de vices possèdent un point faible, l’avarice. La vertu coûte cher. Servir chez les bourgeois est aussi honorable et aussi peu rémunérateur qu’écrire dans la Revue des Deux Mondes.
M. Ploc est un homme sérieux qui rapporte régulièrement à Bobonne la paye du mois. C’est le directeur d’une grande bonneterie. Je ne l’ai jamais vu sourire. Du moins, à la maison. Je jurerais de la vertu de Mme Ploc. Elle n’a sûrement jamais eu d’amant. Je n’en dirais pas autant de M. Ploc. Je le soupçonne vaguement de se distraire prudemment — très prudemment — dans quelques maisons galantes ou chez une demoiselle frivole qui ne connaît pas son vrai nom.*
* *Tous les jours, je sortais me promener avec les trois enfants. Au Bois, je fis la connaissance d’autre bonnes, mes voisines. Je compris alors d’où venait cette précocité chez certains enfants de famille bourgeoise.
Chaque fois qu’une de mes collègues avait l’occasion de conter une histoire leste devant des oreilles d’enfants, elle ne s’en privait pas.
Lucie, par exemple, la bonne d’enfants d’un député connu, une jeune femme qui avait un vrai don de romancière spéciale et qui savait tenir les jeunes haleines en suspens, commençait ainsi :
— Tenez ! L’autre jour, je suis entrée dans la chambre de Madame, sans frapper. Et qu’est-ce que j’ai vu, mon Dieu ! Son ami, tout nu, qui avait confondu ses caleçons avec ceux du mari et qui… (ici, elle baissait le ton, de façon à faire comprendre aux enfants qu’il s’agissait d’une chose particulièrement intéressante et qu’il leur était défendu d’entendre, mais elle parlait assez haut quand même pour être entendue d’eux).
Et elle racontait dans ses plus terribles détails l’entrevue galante de Madame et du gigolo de Madame. Les enfants n’en perdaient pas un mot.
Avec Jeanne, c’était plus grave encore. Quand elle promenait Nini toute pimpante de ses douze ans, elle donnait rendez-vous à son amoureux. Jeanne échangeait les baisers les plus tendres avec son homme, allait parfois jusqu’aux caresses devant une Nini ahurie, les yeux écarquillés, et tellement dégoûtée de ce spectacle qu’elle déclara un jour à ses parents :
— Moi, je veux entrer au couvent. Je ne suis pas faite pour le mariage.
Un soir, Paul m’expliqua :
— Tu sais, Nini, la grande, elle est très gentille. Elle m’a mené voir par le trou de la serrure de la chambre de bonne comment Jeanne et son ami faisaient ça. Tu sais, c’est très drôle !
Je tançai vertement le petit Paul. Mais je me sentais impuissante à changer le cours de ses idées. Tout ce que j’obtenais, c’était un grognement mécontent :
— Dommage que tu ne sois pas à la page comme la bonne de Nini ! J’ai jamais eu de veine.
Le soir même, je donnais mes huit jours à Mme Ploc.Maryse Choisy