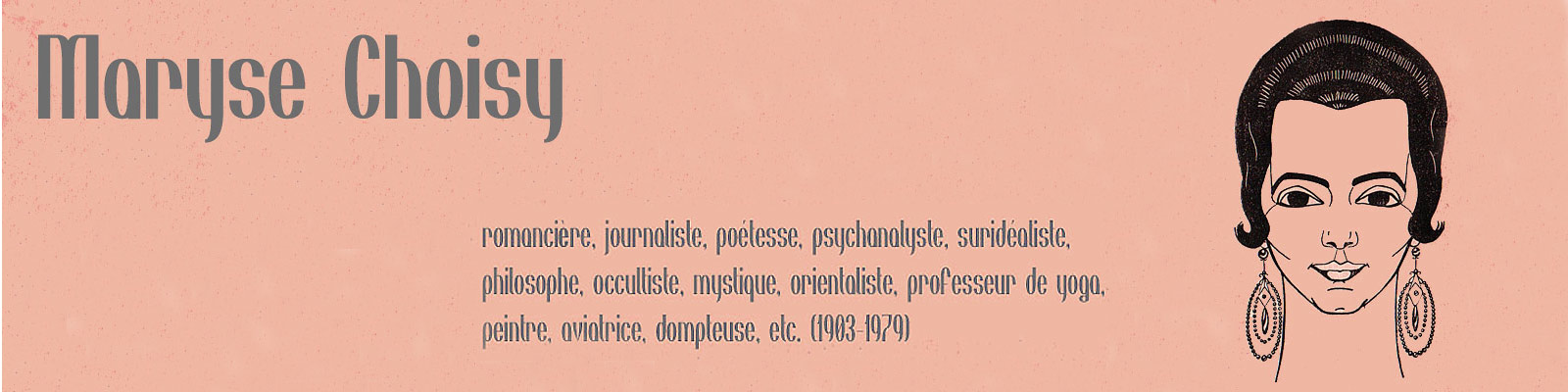Dès le XIXe siècle, les mouvements d’émancipation de la femme ont rencontré des ennemis acharnés, essentiellement des hommes conservateurs et réactionnaires. Mais, ce qui pourrait sembler étrange, il y eut quelques femmes antiféministes, et de plus en plus quand, dans les années vingt, survint la mode « garçonne ».
Dans un petit ouvrage passionnant – Ces femmes antifemmes – aux sources inattendues du genre (Lemieux, 2017) – Bertrand Matot nous présente quelques-unes de ces femmes, qui entre 1920 et 1940, se sont opposées à leurs consœurs féministes. Ces portraits sont accompagnés de larges extraits de leur littérature antiféministe, ainsi que de quelques réponses des émancipées.
Ainsi en est-il de Marthe Borély, nostalgique de l’Ancien Régime et proche de l’Action Française, dont les livres exposant sa théorie du « contre-féminisme » et s’opposant au droit de vote des femmes eurent un grand succès. Cécile Brunschvicg (qui deviendra la première ministre de France) et Suzanne Normand, deux militantes féministes, se sentirent obligées de lui donner la réplique.
La réactionnaire catholique Colette Yver (que tante Anna traduisit en anglais) écrivait des romans où, comme l’écrivait Simone de Beauvoir, « l’avocate, la doctoresse, finissent par sacrifier leur carrière à l’harmonie du foyer » (plus tard, plusieurs romans de Maryse Choisy insisteront sur ces mêmes dilemmes : travail ou amour ? travail ou maternité ?).
Henriette Charasson, autre admiratrice de Maurras, s’attaqua elle aussi, à travers de nombreux articles, à la question du travail de la femme : « J’ai cru autrefois au bienfait, pour la femme mariée, du travail indépendant. Je sais, depuis que j’ai été mère, que le seul travail féminin qui soit admissible, c’est le travail à la maison. »
Quand on connaît le parcours de Rachilde, qui vers 1880 demanda l’autorisation à la Préfecture de Police de porter le costume masculin et qui faisait imprimer sur ses cartes de visite « Rachilde, homme de lettres », on peut être surpris de la voir publier en 1928 un livre intitulé Pourquoi je ne suis pas féministe ? La réponse n’est finalement pas surprenante : elle affirme avoir toujours méprisé les femmes et avoir toujours regretté de ne pas être un homme. « Les femmes sont les frères inférieurs de l’homme, simplement parce qu’elles ont des misères physiques les éloignant de la suite dans les idées que peuvent concevoir tous les hommes en général, même les moins intelligents. […] Il y a des choses qu’elle ne comprend pas, qu’elle ne comprendra jamais. Et est-ce bien utile qu’elle les comprenne ? »
L’aristocrate Valentine de Saint-Point ne prend pas non plus de pincettes dans son Manifeste de la femme futuriste : « Le Féminisme est une erreur politique. Le Féminisme est une erreur cérébrale de la femme, erreur que reconnaîtra son instinct. Il ne faut donner à la femme aucun des droits réclamés par les féministes […] »
Quant à Georgette Varenne, elle s’est essentiellement occupée de valoriser, dans le contexte pétainiste, la femme au foyer : « notre devoir social à nous, les femmes, c’est de contribuer, soit par notre vie familiale, soit par notre action sociale, à restaurer, à mieux organiser cette base de la vie sociale, cette cellule sociale qu’est la famille. »
Les antiféministes ne sont pas toutes de droite ou d’extrême-droite. Gina Lombroso, antifasciste, blâmait la masculinisation de la femme : « La femme copie l’homme, qu’elle déteste soi-disant, parce que l’homme est devenu pour elle un modèle de perfection. […] Le fait même que la femme se masculinise constitue sa défaite. »
Suzanne Nicolitch, militante socialiste, représente l’antiféminisme d’extrême gauche. Pour elle, le féminisme n’est qu’un mouvement bourgeois, « salonnard et bien pensant » et c’est sur le terrain social qu’il faudrait combattre : « Parler de féminisme sans toucher à la question des classes sociales, c’est bon pour une lectrice des Annales ou du Petit Echo de la Mode. Femmes, le problème ne vous a pas été souvent montré sous son vrai jour. Vous qui voulez vous libérer et libérer ceux qui viendront après vous, comprenez ceci : ce que vous croyez être l’esclavage du sexe n’est au fond qu’une des formes de l’esclavage d’une classe sociale. […] Femmes, ce n’est pas parce que vous êtes femmes que vous souffrez le plus du monde actuel. C’est parce que vous êtes les cellules les plus faibles d’un grand corps social mal organisé ».
Nous avons gardé pour la fin le chapitre consacré à Maryse Choisy. Bertrand Matot a choisi, pour illustrer son portrait de cette femme étonnante, de larges extraits d’une réponse qu’elle fit en 1927 à une enquête de Fernand Divoire intitulée La Femme émancipée. Réponse bien dans le ton du « suridéalisme », mouvement qu’elle lance à la même époque. Les premiers mots frappent : « Nous courons à l’émancipation comme un païen déçu vers un nouveau Dieu, comme un dilettante blasé vers une volupté inédite, comme un enfant vers un jouet inconnu. Nous revêtons la liberté comme on change de souffrance, comme on abandonne le rythme de ses joies et de ses douleurs passées avec la robe qu’on a portée au printemps, que l’on ne mettra plus, jamais plus… » Le refrain « Nous sommes devenues comme des hommes » rythme sa prose, agrémenté de phrases cinglantes : « Nous voulons à notre tour faire souffrir au lieu de souffrir », « Seulement, nous n’avouons pas que nous nous sommes trompées ». La question du travail des femmes est là aussi prédominante, qui lui fait dire : « Le féminisme n’est pas un remède efficace. C’est souvent un cercle vicieux. »
Malgré tous ces extraits qui pourraient heurter beaucoup aujourd’hui, on peut s’étonner que la plupart de ces femmes soient essentialisées sous le terme d’ « antiféministes », et bien plus encore sous celui, curieux, d’ « antifemmes ». Pour ne parler que de Maryse Choisy, tout son parcours et ses livres relèvent d’une certaine forme de féminisme, qui, certes se permet de faire des reproches à d’autres formes de féminisme, et par exemple à celui porté par celles qu’elle a nommé, avec d’autres, les « précieuses radicales ». D’ailleurs, plusieurs passages de sa réponse à l’enquête de La Femme émancipée se retrouvent, au sein de son roman Mon coeur dans une formule, dans une discussion de salon bourgeois.
Son Manifeste du suridéalisme, de cette même année 1927, est une profession de foi féministe à sa manière : « Nous sommes les femmes du prochain avion. […] Nous ne voulons plus enrôler nos gestes à d’autres gestes. Foin de la prison égalitaire ! Foin des opinions remâchées ! Foin des nivellement imposés ! Foin des préjugés ! Foin des graisses lâches qui envahissent la musculature de l’action ! Le suridéalisme nous servira à sortir de cinq siècles de matière humaine. […] Notre siècle est le siècle de la jeunesse. Mais c’est aussi le siècle de la femme. La civilisation purement masculine est un échec. A la femme de donner le ton, ce qui ne veut pas dire que nous excluons l’homme de nos chansons et de nos assemblées. Nous sommes plus généreuses, plus indulgentes. »
On voit qu’à cette époque, elle est déjà, dans ce qui relève bien du féminisme, pour la « paix des sexes », qu’elle appellera longtemps de livres en livres (cf. La Guerre des sexes).
Bref, Maryse Choisy n’est pas antiféministe, et encore moins antifemme.
Bertrand Matot, ceci dit, n’affirme pas exactement le contraire, concernant toutes ces femmes oubliées qui se sont opposées au mouvement féministe : derrière ces débats, il discerne des femmes « passionn[ées], avant tout, pour la question de l’identité sexuelle », d’où le sous-titre à son anthologie, aux sources inattendues du genre.